Xavier Roseren
Député de la 6e circonscription de Haute-Savoie
Bienvenue à toutes et tous sur mon site internet !
Originaire de Chamonix, je vis actuellement sur le commune des Houches où je suis commerçant.
D’abord maire des Houches en 2014, j’ai été élu en juin 2017 puis réélu en 2022 député de la majorité présidentielle. Je siège à la commission des Finances qui contrôle et vote le budget de l’Etat.
Ces expériences de commerçant et d’élu local me sont utiles au quotidien à l’Assemblée nationale. Elles me permettent de garder les pieds sur terre et de savoir de quoi je parle.
J’entretiens un lien essentiel entre le territoire, ses habitants et les institutions parisiennes, à l’Assemblée nationale et dans les ministères.
C’est l’essence même de mon rôle de député que de défendre les réalités de nos territoires, représenter leurs particularités, mettre en avant leurs atouts mais également souligner leurs difficultés.
Vous trouverez sur ce site internet l’ensemble de mon activité parlementaire et de son actualité, ainsi que mes coordonnées pour me solliciter.
Je me tiens à votre disposition pour échanger avec vous.

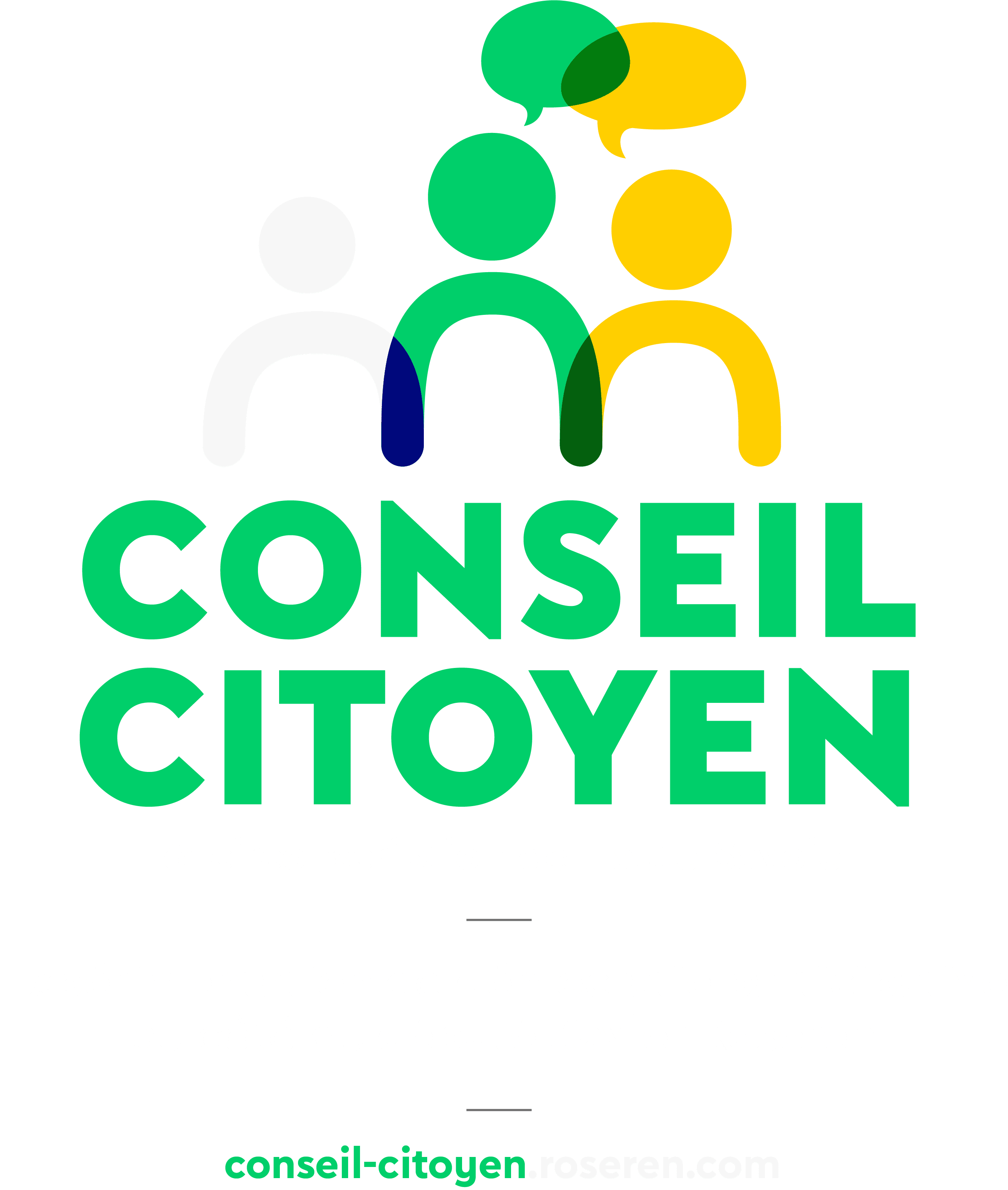
🧠 L’idée générale
L’objectif : faire de notre territoire un exemple à suivre en devenant un laboratoire de démocratie participative ! En bref : faire confiance à l’intelligence collective.
🤔 Pourquoi ?
Pour intégrer davantage les citoyens dans le fonctionnement de leurs institutions, en particulier celui de l’Assemblée nationale.
🎯 Le principe ?
Xavier Roseren réfléchit collégialement avec le Conseil Citoyen, sur des thèmes précis, en lien avec le territoire, à ses interpellations de ministres, à l’élaboration d’amendements sur des projets de loi, à son vote même parfois dans l’hémicycle.
🧐 Par quels moyens ?
Les échanges et consultations fréquents avec le Conseil Citoyen ont lieu via la plateforme en ligne, par réunions en visioconférences et dans le cadre de réunions annuelles en présentiel.
La plateforme en ligne permet de manière plus occasionnelle de consulter très largement tous les citoyens de la circonscription !
Actualités
Soutien à la petite enfance à Combloux
Ce vendredi 12 avril, nous avons officiellement lancé le chantier de la Maison de l'Enfance de Combloux. Pour garantir une vie à...
L’Etat soutient les investissements des collectivités locales de la Haute-Savoie
Le soutien de l’Etat aux collectivités locales en Haute-Savoie a atteint un record en 2023 : le niveau inégalé de près de 40...
Chômage des frontaliers : trop c’est trop !
Le coût d'indemnisation du chômage frontalier a explosé, passant de 540 à 920 millions d'euros entre 2012 et 2020. S’agissant de...
Notre ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti annonce des recrutements importants en Haute-Savoie !
Visite de notre ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti au tribunal judiciaire d'Annecy, où il vient annoncer 17 recrutements...
Intervention en soutien aux moniteurs stagiaires de ski
Ce mercredi 27 mars, j'intervenais dans l'hémicycle en tant qu'orateur du groupe Renaissance, sur la proposition de loi visant à...
Visite de la ferme pour tous, à Domancy
Visite d'Une ferme pour tous, au pays du Mont-Blanc avec l'Addear 74, afin de présenter cet exemple d’organisation collective....





